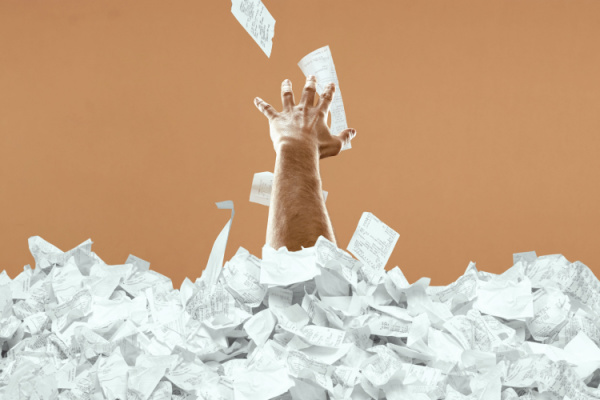Si le regroupement de crédits peut être une solution dans certains cas, elle peut aussi aggraver l’endettement. C’est pour cette raison que les pratiques des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) sont encadrées. L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a mené une série de contrôles auprès des différents professionnels. Et les résultats sont…plutôt mauvais…
Regroupement de crédits et rôle des intermédiaires : de quoi parle-t-on ?
Pour rappel, le regroupement de crédit consiste à racheter tout ou partie des crédits d’une personne et de les regrouper en un seul. L’objectif est de rassembler toutes les mensualités de divers prêts (crédit immobilier, à la consommation, professionnel, etc.) pour n’en faire qu’une seule, moins importante.
Pour réduire le montant des mensualités, le nouveau crédit est allongé. Concrètement, le remboursement sera moins lourd chaque mois, mais plus long. Il y aura donc plus d’intérêts à payer au final.
Si cette technique peut permettre à certaines personnes de faire face à leurs dettes, elle peut aussi aggraver leur situation financière. Elle doit donc être utilisée avec prudence et faire l’objet d’une information claire et complète.
Pour obtenir un regroupement de crédits, il est possible de s’adresser à un intermédiaire en opération de banque en services de paiement (IOBSP). Son activité consiste à présenter, proposer et aider à la conclusion des opérations de banque et services de paiement. Il effectue tous les travaux et les conseils préparatoires à leur réalisation auprès du client.
Il existe plusieurs professions dans la catégorie IOBSP :
- le courtier en opérations de banque et en services de paiement, qui a un mandat auprès d’un client et qui n’a pas l’obligation de travailler avec un établissement de crédit ou de paiement particulier ;
- le mandataire en opérations de banque et en services de paiement, qui a un mandat auprès d’un ou plusieurs établissement de crédit ou de paiement ;
- le mandataire d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui est le mandataire d’un courtier ou d’un mandataire en opération de banque et en services de paiement (notez qu’un mandataire d’intermédiaires ne peut pas lui-même avoir un mandataire).
Ces professionnels doivent apporter un certain nombre d’informations afin de répondre au mieux aux besoins du client. Ils doivent en particulier :
- s’identifier clairement auprès du client ;
- indiquer leur rémunération ;
- identifier les besoins du client et ses connaissances en matière financière ;
- expliquer l’opération, évaluer et présenter son bilan économique et les risques potentiels.
Regroupement de crédits et rôle des intermédiaires : à clarifier !
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a relevé des irrégularités tout au long du processus de commercialisation du regroupement de crédit.
Informations précontractuelles
Certains IOBSP entretiennent le flou sur leur statut : alors qu’ils doivent s’identifier clairement auprès du client, ils se présentent, à tort, dans leur documentation sous le seul nom de la marque commerciale ou du réseau de distribution.
De plus, la documentation minore souvent la rémunération véritable de l’intermédiaire.
Recueil insuffisant d’informations sur le client
L’ACPR a noté que les informations demandées aux clients pour monter l’opération sont insuffisantes. Ainsi, ne sont pas demandées les informations sur l’objectif du client, son besoin ou non de trésorerie supplémentaire, la composition de son foyer familial, son imposition, ses types de revenus, une baisse prévisible de revenus, etc.
Des surcoûts qui peuvent être évités
Si la règle veut qu’une telle opération n’implique pas plus de 2 IOBSP, dont un courtier maximum, en pratique, les chaînes de courtage peuvent être plus longues, ce qui engendre à chaque intermédiaire des coûts supplémentaires.
Dans le montage lui-même du regroupement de crédits, 2 postes de coûts potentiellement irréguliers ont été relevés.
En effet, les IOBSP intègrent quasi systématiquement, sans l’accord de leur client :
- leur rémunération, quand bien même le client aurait l’argent disponible pour payer directement ;
- une trésorerie supplémentaire, quand bien même le client n’en aura pas fait la demande.
Cet argent à rembourser constitue des intérêts supplémentaires à acquitter à chaque mensualité. L’ACPR soulève ici un conflit d’intérêt : la rémunération des IOBSP est proportionnelle au montant à financer par le rachat de crédit…
Devoir d’alerte et d’informations à revoir
L’ACPR a relevé que les IOBSP peuvent se contenter d’un rôle d’intermédiaire « passif » dans la chaîne, sans apporter de conseils ou d’éclaircissements supplémentaires.
L’offre de rachat de crédits est parfois envoyée directement au client qui n’est donc pas accompagné dans sa lecture.
Les IOBSP n’apportent pas systématiquement leur conseil pour expliquer l’engagement induit par ce regroupement de crédits, pour comparer la situation avant et après le rachat et chiffrer le coût de l’opération total, etc.
Les alertes sur ces engagements et leurs conséquences sont insuffisantes, de même que l’information relative aux primes assurance-emprunteur, présentées comme facultatives, mais qui ont pourtant un coût non négligeable.
Pratiques des intermédiaires en regroupements de crédits : ménage de printemps demandé ! – © Copyright WebLex